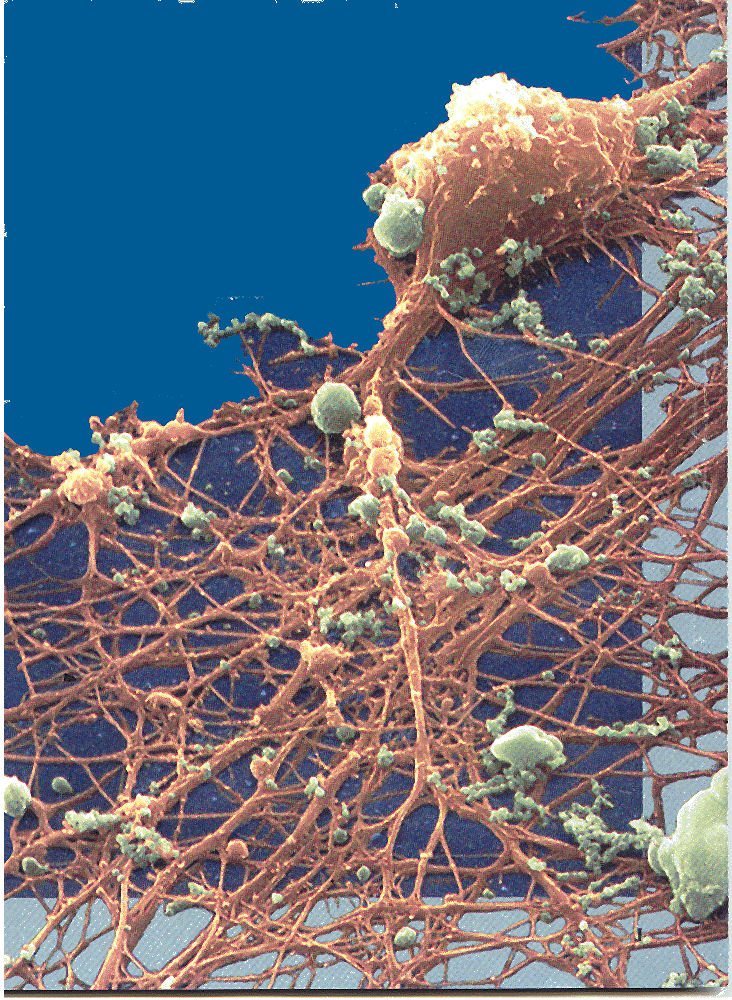Pensée, conscience, savoir, intelligence.
1 - La pensée a besoin d'un cerveau et d'un système nerveux
L'Homme est bien plus complexe que l'animal en général et, pour lui, la vie va bien au-delà du simple fait d'exister. Ce qui fait l'originalité de l'Homme, dans le règne animal auquel il est intégré, ce n'est pas seulement qu'il fasse partie du genre Homo; c'est surtout que cet Homo soit Sapiens.
L'Evolution ne s'est pas arrêtée à l'élaboration progressive d'un corps qui soit seulement capable de se maintenir dans le temps et de se reproduire. Elle a poursuivi son œuvre de complexification en dotant progressivement ce corps d'organes capables de sentir l'environnement, de communiquer avec lui, de traduire ces communications en sensations. Ces sensations ont alors conduit au développement d'un système nerveux, en général, et d'un cerveau, en particulier, doté, sans doute au départ, seulement d'une fonction de stockage: la mémorisation. La poursuite du développement et de la complexification a induit le développement - on parle d'émergence - d'une pensée qui s'est organisée en savoir, puis d'une conscience et enfin d'une intelligence. La question de la pensée et de la conscience est une question aussi compliquée, aussi dangereuse, aussi tabou, que la question de l'existence elle-même ! Cette question a déjà occupé de nombreux théoriciens et philosophes, et plus récemment des biologistes et neurophysiolologistes. S'il est aisé, aujourd'hui, d'étudier un organe, une cellule, un gène…, il paraît plus difficile en effet, de décortiquer une "matière" aussi volatile, aussi virtuelle, que la pensée ou de mettre en place un protocole expérimental qui permette, comme le permet toute expérience revendiquant le caractère de scientifique, d'établir des conclusions sûres, irréfutables et reproductibles. Les vingt dernières années ont cependant permis d'échafauder des théories sérieuses en la matière.
1 - Pour se développer, la pensée a besoin d'un cerveau et d'un système nerveux. Le minéral - un caillou par exemple - se contente d'être: Il est caillou et reste caillou. Il peut, par action de l'environnement devenir grain de sable ou élément d'une construction, mais jamais par une action qui lui est propre. Si le caillou reste caillou, inerte, c'est parce qu'il n'est que la simple somme de ses composants, certes structurés suivant une certaine géométrie, mais sans qu'il compte lui-même pour quelque chose dans son existence.
La plante (comme la plupart des végétaux) se trouve dans un état d'organisation de sa matière supérieur au niveau d'organisation du minéral. Elle est dotée d'un système sensitif et d'un système hormonal. Elle est sensible, par exemple, à la lumière solaire dont elle tire son énergie pour fabriquer sa matière par photosynthèse, ce qui lui permet de se nourrir de façon autonome. Ses cellules sont pourvues de la molécule d'ADN, molécule de la vie qui lui permet de se multiplier, de se reproduire. Pourtant la plante, elle aussi, se contente d'être et de vivre sa vie de manière passive; moins passive certes, que le caillou, ce qui est donc une avancée, mais bien plus passive qu'un animal. Son système sensitif est encore insuffisamment développé pour dépasser le stade de la vie végétative. L'animal possède un niveau d'organisation supérieur à celui de la plante puisqu'il est capable de se déplacer et d'avoir un degré supérieur d'autonomie de vie. Il ne dépend pas, comme la plante, des éléments aléatoires (vent, eau, vecteurs pollinisateurs) pour se reproduire. Il possède un système nerveux développé connecté à un cerveau. Ce système nerveux et ce cerveau sont plus ou moins développés suivant les espèces. D'un simple amas de cellules nerveuses chez les invertébrés il y a organisation d'un véritable système nerveux complexe chez les mammifères. Cependant, même chez les animaux supérieurs, le cerveau reste bien moins développé que chez l'Homme. S'il permet, chez certaines espèces, l'accès aux émotions et à certaines fonctions comme l'apprentissage, il ne permet pas encore d'accéder à une pensée structurée et encore moins à une conscience. Ainsi un chien dispose de moyens rudimentaires de communication (aboiement, comportements) mais ne dispose pas de la faculté de penser, notamment parce qu'il ne dispose pas de la parole. La parole, expression du langage, nécessite en effet de produire non seulement des signes et des sons abstraits mais aussi des images mentales, des représentations, et qui plus est, de les produire en y incluant une intention, ne serait-ce que l'intention de communiquer avec autrui. Tout comme la plante, l'animal "est" mais il ne vit pas intentionnellement et n'a qu'exceptionnellement "conscience de son être". L'anthropologie nous apprend qu'au cours de l'Evolution, le volume du cerveau a, sans cesse, progressé en taille, passant d'un volume de 500 centimètres cubes chez l'Australopithèque, à 1500 centimètres cubes chez Homo Sapiens, l'Homme moderne, soit en deux millions d'années seulement. On ne sait cependant pas dire si ce sont les informations de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes qui ont "poussé" les parois du cerveau pour les abriter, ou bien si c'est le cerveau lui-même, et la boîte crânienne qui se sont développés, donnant du coup un espace supplémentaire aux informations … qui en auraient profité pour se développer. L'Homme a, en tout cas, bénéficié au cours de l'Evolution, d'un cerveau qui a triplé de volume et qui a vu sa structure se complexifier au point de permettre la production d'une pensée, d'une conscience, d'une intelligence. Grâce à ce cerveau, l'Homme est, et a conscience d'être. Selon une expression chère à Albert Jacquard : "il se sait être". Disant cela, Albert Jacquard sous-tend que c'est le cerveau, c'est-à-dire la matière - cette fameuse matière grise - qui produit la conscience, et la pensée en général. Si aujourd'hui une grande majorité de la communauté scientifique admet ce principe d'unicité de la matière et de l'esprit, issue pour l'essentiel de la théorie darwinienne de l'Evolution, cela n'était pas le cas pendant des lustres. Depuis Socrate jusqu'à Descartes, c'était le dualisme qui faisait autorité, c'est-à-dire l'idée que le corps et l'esprit étaient deux choses entièrement séparées. La nature de l'esprit était considérée comme étant d'ordre transcendantal. Si l'esprit cohabitait et interagissait avec le corps ce n'était pas par nature mais juste pour les besoins de la cause. Ce n'est que depuis le développement des neurosciences, c'est-à-dire depuis la deuxième moitié du XXème siècle, que le dualisme est profondément remis en cause et que l'on considère l'esprit comme le résultat d'une organisation particulière de la matière, celle qui constitue notre système nerveux. Mais comment peut-on définir ce que nous appelons système nerveux ?
Le cerveau et les neurones Lorsque l'on parle de cerveau on ne parle que d'une partie, la plus importante certes, mais qui ne représente qu'un des éléments d'un système beaucoup plus vaste puisqu'il concerne le corps entier: le système nerveux. On peut scinder le système nerveux en deux parties: le système périphérique et le système central. Le système périphérique peut se définir comme un réseau de communication très complet, très détaillé, très ramifié, qui innerve les moindres parties du corps. Ces "fibres" qui parcourent le corps se rassemblent au niveau de la moelle épinière et se connectent au cerveau par l'intermédiaire du tronc cérébral. Moelle épinière et cerveau constituent le système nerveux central. Le cerveau est, tout à la fois, un centre de coordination, de création et de décision. Comme tous les tissus qui forment notre corps, le système nerveux est formé de cellules assemblées entre elles. Elles sont d'un type un peu particulier et s'appellent des neurones. Les neurones contribuent grandement, avec le système hormonal et le système lymphatique, au fonctionnement et à la régulation de l'organisme; ils contrôlent les relations avec le milieu extérieur et engendrent les fonctions mentales ou, en tous cas, leur servent de support biologique. La caractéristique la plus impressionnante de ces neurones est leur nombre: La seule partie externe du cerveau, les circonvolutions corticales - ce que l'on appelle communément la matière grise - compte dix milliards de neurones. Fait encore plus impressionnant, chaque neurone peut établir avec d'autres neurones d'innombrables connexions nommées synapses. La couche corticale contient un million de milliards de connexions. Gérald Edelman a calculé que "Au rythme d'une connexion (synapse) par seconde, il vous faudrait quelque trente-deux millions d'années pour les compter toutes" ! Les neurones, connectés entre eux, forment des réseaux. Les réseaux neuronaux sont eux-mêmes reliés aux différentes parties du cerveau; chaque partie est le siège de fonctions spécialisées. Dans certains cas les parties fonctionnent indépendamment les unes des autres; d'autres fois des ponts s'établissent entre elles. Ces réseaux se sont développés, au cours de l'Evolution, un peu comme les sédiments qui se déposent dans les fonds marins: par couches successives. L'étude anatomique du cerveau, associée à l'étude fonctionnelle, permet de distinguer différents "cerveaux" qui correspondent à des stades évolutifs caractéristiques des grands groupes d'animaux qui ont précédé l'Homme dans la phylogenèse. Nous allons les passer rapidement en revue.
Cellules nerveuses du cerveau humain vues au microscope électronique à balayage (MEB). En haut, un neurone dont part un axone, qui transmet les messages aux autres neurones, et les dendrites, plus fines, qui reçoivent les messages. Les messages constituent l'influx nerveux qui circule des ce réseau à une vitesse qui peut varier de quelques mètres par seconde à une centaine de mètres par seconde.
Le cerveau reptilien ou le minimum vital. Les reptiles sont en général carnassiers et leur agressivité se manifeste envers leurs proies dans la situation de chasse pour assurer les besoins de leur survie. Elle se manifeste aussi par réflexe de défense lorsqu'ils se sentent menacés. Réflexes de prédation et de défense résultent de l'application des comportements stéréotypés engrammés dans leur système nerveux. C'est pourquoi on qualifie de cerveau reptilien la partie du cerveau la plus ancienne et la plus primaire: celle qui permet les comportements assurant la survie par la prédation et la défense. Ce cerveau ancestral, constitué de la partie originelle des hémisphères cérébraux, date de 200 millions d'années, époque où la Terre était colonisée par une végétation luxuriante et envahie par les reptiles: sauriens et dinosaures. Il permet également d'autres comportements stéréotypés comme l'établissement des territoires de chasse et de rut chez les animaux sauvages, aussi bien que chez l'homme de Neandertal, l'établissement des hiérarchies sociales, la sélection des chefs, les comportements de lutte ou de fuite en cas de conflits, l'assouvissement de la faim et de la soif ... Cette mémoire ancestrale des comportements types ne permet pas de faire face, avec logique, aux situations nouvelles qui se présentent. Elle permet seulement de répondre à une situation déjà connue. Elle est le siège de tous les fonctionnements réflexes et inconscients. Il arrive parfois que nous ne comprenions pas tel geste ou tel comportement de nos compatriotes, voir de nous-mêmes. Lorsque nous ne disposons pas des éléments suffisamment patents on finit couramment par admettre "qu'il en est ainsi..." ou encore que "c'est dans la nature humaine". En réalité, le comportement en question est déterminé par ce cerveau reptilien qui permet de lutter efficacement pour le maintien de la structure, c'est-à-dire pour le maintien de la vie, conformément aux pulsions, aux instincts, aux codes gravés dans la mémoire ancestrale. Mais ce cerveau qui ne nous permet que de réagir d'instinct, ne nous livre pas forcément les clés du décodage propres à la conscience.
Le système limbique: l'instinct et les premières émotions. Le cerveau limbique (que les savants distinguent en hippocampe, amygdale, septum et hypothalamus) représente une avancée évolutionniste par rapport au cerveau reptilien. Il caractérise le cerveau des mammifères et joue un rôle fondamental dans les activités émotionnelles comme la peur, la colère, la joie, ainsi que dans les activités endocrines viscérales ou somatiques. La peur par exemple provoque la sécrétion d'adrénaline qui raidit les muscles et prépare le corps à une riposte éventuelle. Chez l'Homme le système limbique est le siège du fonctionnement réflexe et instinctif. Il participe également au stockage des références, à la mise en mémoire à long terme et au maintien de la structure. Cerveau reptilien et système limbique constituent un ensemble également appelé paléocéphale, responsable des manifestations telles que les sueurs froides, les accélérations du rythme cardiaque au cours des émotions fortes, le souffle coupé par l'angoisse, la chaleur qui nous pénètre lorsque l'on ressent le plaisir, le relâchement musculaire (détente du bonheur) après l'accomplissement d'un acte sexuel. Les comportements paléocéphaliques ont pu être mis en évidence grâce au développement simultané de la pharmacologie et de la neurophysiologie. L'étude des effets des drogues et des neuroleptiques a permis de préciser les centres nerveux et les mécanismes mis en jeu.
Le néo-cortex: l'usine de l'intelligence. Il représente la partie la plus récente dans l'évolution du cerveau. Il ne s'est réellement développé que chez les mammifères les plus évolués (chimpanzés et grands singes) et chez l'Homme. Il occupe toute la zone antérieure (lobe orbito-frontal) du cerveau humain. C'est la zone associative du cerveau, celle qui permet d'assembler les éléments de mémoire qui servent de base à l'élaboration de la pensée. Ce faisant il permet des comportements, qui au lieu d'être automatiques ou stéréotypés, seront au contraire, de plus en plus originaux et inédits. C'est la base fonctionnelle de l'imagination, de la création, des activités autonomes sur l'environnement, de l'anticipation (vision hypothétique de l'avenir proche), de la programmation du futur. Le néo-cortex est le lieu où se développent le savoir et l'intelligence.
|
|||||||||||||||||||||

 Par Anicet Le Marre
Par Anicet Le Marre