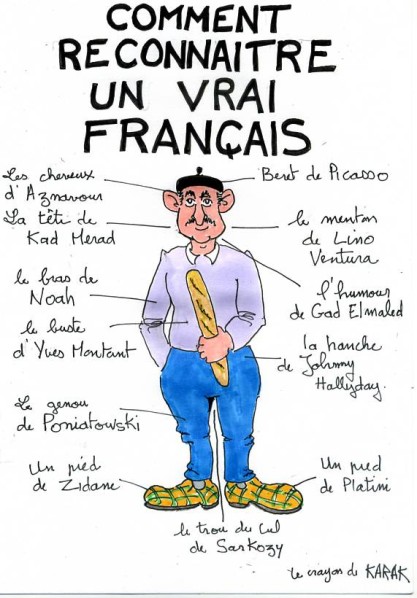Les devoirs du citoyen
La
notion de devoir renvoie à la notion de dette. Les devoirs du citoyen sont la contrepartie de l'usage des droits. Les devoirs sont de deux natures, juridique et morale. Ils concernent deux cibles: les devoirs envers l'Etat et les devoirs envers autrui. Sur le plan juridique, le citoyen doit respecter la loi, qu'il est censé ne pas ignorer. La loi énumère et définit les devoirs édictés dans un ensemble de recueils nommés codes: code civil, code pénal, code de la route, code du travail, code du commerce, code maritime, code rural, code de la sécurité sociale, code des impôts... et une multitude d'autres codes qui sont consultables sur le site Légifrance. Pour autant, les devoirs du citoyen ne se limitent pas à des obligations juridiques; ils doivent être complétés par une dimension morale et répondent à des critères non écrits et qui sont plutôt d'ordre consensuel: code moral, code de bonne conduite, code de déontologie... Sur le plan moral, la Déclaration des Droits de 1789 (article 4) établit que "l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits". Dans la vie de tous les jours, chaque citoyen doit donc respecter les droits des autres, qui sont identiques aux siens. Ainsi, un citoyen a droit au respect de sa vie privée et doit en échange respecter scrupuleusement celle des autres. La politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenneté vécue au quotidien. Le respect mutuel des citoyens, signe de la civilité, est primordial pour rendre supportable la vie en société. Les étrangers et les immigrés qui sont accueillis dans "le pays des droits de l'homme" ont, bien naturellement, les mêmes droits que tous les Français. Dès leur arrivée ils ont, tout aussi naturellement, le devoir de respecter les règles qui prévalent en France. Les personnes ont le droit, en vertu de la laïcité, de se regrouper en fonction de leurs affinités (origine ethnique, géographique, communauté de langue, de religion...). Mais elles ont pour autant le devoir de se conformer à la loi française. Ainsi par exemple, n'ont-elles pas à vouloir substituer les règles ou les spécificités de leur communauté d'origine, ni les traditions d'où elles viennent, aux règles en usage en France. Vouloir le faire serait faire preuve de communautarisme.
Un devoir peut en cacher un autre: le devoir de désobéissance "Lorsque les valeurs et les fondements de la légitimité démocratique sont bafoués par les gouvernements, même s’il s’agit de gouvernements issus d’élections démocratiques, la désobéissance acquiert un caractère de légitimité". Stéphane Hessel "Indignez-vous"
Dans sa Constitution notre démocratie précise (Article 2) que son principe est le "gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple". Si c'est le peuple qui fait la loi, il apparaît donc parfaitement légitime d’obéir à la loi. Cependant, il peut arriver que le gouvernement échappe au peuple et que ce gouvernement, devenu autocratique, impose à ce peuple des obligations ou des actes contraires à l'éthique ou même au simple bon sens. Dans ce cas tout citoyen conscient a le devoir de désobéissance civile. Henry David Thoreau dans son essai sur "Le devoir de Désobéissance Civile" disait: "Je dois faire en sorte de ne pas prêter la main à faire le mal que je condamne".
Notre constitution, se référant à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, reconnait elle-même comme droit imprescriptible la résistance à l’oppression. La désobéissance civile peut être définie comme une infraction consciente et intentionnelle, un acte public et pacifique à vocation collective. Son but est de modifier la règle ou la loi jugée injuste, ou de s'opposer à la poursuite d'actions dangereuses pour l'environnement, pour l'humanité.
Exemples de désobéissance civile:
Droit de vote n'est pas Devoir électoral Il est un devoir dont on parle beaucoup en matière civique: le "devoir électoral". Or en France, le droit de vote est un droit et n’est pas, juridiquement, une obligation. Cela signifie que le citoyen peut ne pas exercer ce droit, comme pour tout autre droit (ex: liberté de réunion ou d’association. Ce n'est pas parce que le droit d'association existe que l'on doive nécécessairement l'exercer!). En France, l'opinion publique "bien pensante" considère pourtant que voter est un devoir moral envers la Société. Force est de constater cependant que le parti de plus en plus majoritaire devient celui des abstentionnistes (voir la page vote-élection-abstention) montrant ainsi que les abstentionnistes entendent utiliser leur droit de vote comme un droit de non-vote.
Cette façon d'utiliser le mot devoir à la place du mot droit a été instituée par la classe dominante pour justifier que la simple existence d'élections suffit à qualifier notre société de démocratie. Dans les pays d'Europe (Belgique, Suisse, Grèce) où le vote est obligatoire sous peine d'amende, on observe des effets pervers sur les résultats (augmentation des votes blancs, nuls ou extrémistes) signifiant une opposition des citoyens à une telle obligation. En Italie le vote a été obligatoire jusqu'en 1993; aux Pays Bas de 1917 à 1970.
|
||||||||